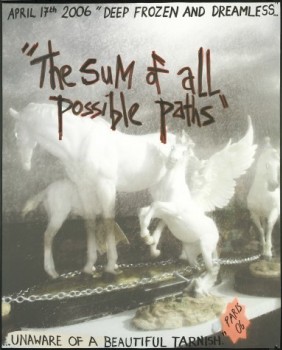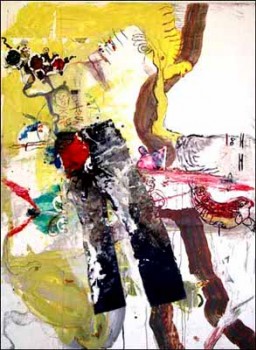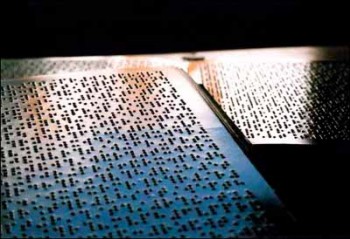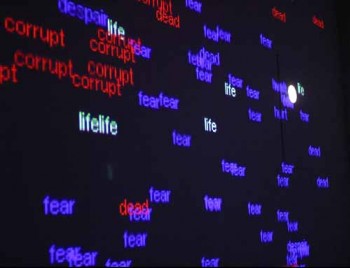Un espace et une temporalité extensibles
Conçues en 1981 et d’apparence très simple, les sculptures regroupées dans les installation 1000 Names et To reflect an intimate Part of the Red ( 1981) contiennent déjà une caractéristique constante des oeuvres d’Anish Kapoor : leurs propriétés physiques défient leur stricte limitation spatiale et provoquent une instabilité de la forme. Les pigments colorés affirment leur nature volatile en débordant les contours des sculptures. Le regard passe simultanément de la matière pigmentaire brute à son actualisation dans une forme. La « sculpture » déborde son identité d’objet en soi pour s’apparenter à un phénomène en devenir.
Le temps est l’autre donné intangible auquel Anish Kapoor se mesure. Non pas le temps commun des horloges mais celui, singulièrement éprouvé, du ressenti. Une pièce comme Ishi’s Light inscrit le spectateur dans sa structure enveloppante. Sa forme convexe l’isole dans une coque protectrice. En neutralisant l’environnement immédiat, Anisk Kapoor crée une parenthèse méditative. Espace et Temps : deux dimensions de l’expérience qu’il dilate pour intensifier l’aptitude du regardeur à ressentir par lui-même.
La fusion de l’extérieur et de l’intérieur
Les dispositifs récents d’Anish Kapoor tendent à envahir de plus en plus l’espace pour s'y affronter et parfois l'englober. Elles absorbent le ciel (Sky Mirror, 2006), s’enracinent dans le sol (Suck, 1998), avalent les architectures (Taratantara, 1999) et happent le spectateur dans leur surface concaves et réfléchissantes. Elles commandent une dialectique complexe où le dedans et le dehors s’interpénètrent et se livrent à un jeu de force permanent. La suprématie de l’un sur l’autre est mise en jeu, renégociée, objet d’un équilibre précaire. Un titre d’oeuvre comme Turning the World Upside Down est emblématique de cet espace en mutation constante. En sculpteur total, Anish Kapoor se mesure à l’espace dans sa globalité. Il façonne ce donné intangible qui structure notre perception en travaillant les passages entre les vides et les pleins, les espaces ouverts (qu’il condense par des jeux de réflexion, des surfaces miroitantes) et fermés (qu’il dilate en les forçant ou en creusant des passages).
En court-circuitant la distance entre le visiteur et l’oeuvre, Anish Kapoor rejoint une conception romantique de l’oeuvre d’art perçue comme fusion de l’esprit avec le monde sensible. Certaines de ses sculptures s’apparentent d’ailleurs à un corps ouvert, une membrane dont l’épiderme, parfois tendu en forme de trompe, absorberait toutes les données sensibles. C’est vers cette fusion d’ordre épidermique avec l’oeuvre qu’Anish Kapoor pousse le spectateur à son insu. L’emploi de la couleur joue un rôle central dans cette stratégie d’immersion. Connu pour sa propension à exciter et à émouvoir en accélérant le flux sanguin, le rouge est la couleur qu’il choisit pour noyer l’architecture du Grand Palais. Happé dans une plage colorée continue et vibratoire, le regardeur intériorise la couleur qui s’impose à lui. Il perd pied avec les données objectives du temps et de l’espace et fait l’expérience d’un vertige. Devant une oeuvre d’Anish Kapoor ( par exemple ses disques luminescents où le « fond » se dérobe), il n’est par rare que la main veuille prendre le relais de la perception pour vérifier une intuition, se raccrocher à quelque chose de tangible dans un espace fuyant. C’est tout le sens de la pièce intitulée The Heeling of St Thomas ( 1990) où une plaie rouge fissure un mur. Le spectateur est lui-même fissuré dans ses certitudes, contraint à se perdre pour reconstruire, dans un temps second, sa relation avec l’oeuvre.
Trous, vulves et plaies
Il est fréquent que les sculptures creuses d’Anish Kapoor prennent l’apparence de vulves ou de plaies. Ces métaphores corporelles renvoient simultanément à l’idée de vulnérabilité et de naissance. Dans un entretien avec Anish Kapoor, Gilles A. Tiberghien dit au sujet de Paint Train que « l’on ressent très puissamment cette pénétration (d’un bloc de cire dans un couloir) comme une violence. » En l’occurrence, les oeuvres d’Anish Kapoor forcent aussi l’intimité du spectateur en la manipulant et en la bouleversant. Elles le place dans des conditions physiques qui le rendent poreux et malléable. On retrouve cette idée, abordée précédemment, d’un espace de friction créé entre deux échelles dont la suprématie de l’une sur l’autre se redéfinit constamment. Chez Kapoor, l’oeuvre impressionne le spectateur. Nous sommes loin de l’assertion duchampienne qui affirme que « ce sont les regardeurs qui font le tableau ». Des œuvres d’Anish Kapoor, radicalement baroques au regard de cette approche conceptuelle, on pourrait écrire exactement l’inverse : que « c’est l'oeuvre qui fait les regardeurs ». Suivant la logique de paradoxes et de renversements qui anime chaque proposition d’Anish Kapoor, le contemplateur est d’abord manipulé par l’œuvre mais cette aliénation n’est qu’un passage au terme duquel il se redécouvre en tant que sujet.
avril 2011.
Texte écrit dans le cadre de mes activités de guide conférencière à la Monumenta 2011.