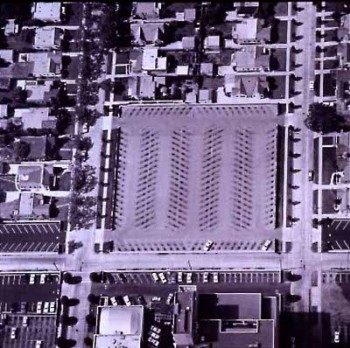Par ce déséquilibre entre le haut et le bas des sculptures, l’artiste semble vouloir faire coïncider deux conceptions du temps. Celui qui court, rythmé par les saisons qui passent, et l’idée de temps comme éternel retour du même, représentée par les immuables canons de beauté grecs, cariatides supportant la métamorphose des saisons.
La facture lisse du marbre unifie et suspend les corps dans leur mouvement, tandis que la surface accidentée des blocs maintient les figures à un stade d’inachèvement, dans la tension d’un devenir.
L’automne et le printemps sont représentés comme des saisons transitoires. Le bloc qui les personnifie représente deux bustes l’un derrière l’autre, peinturlurés en blanc et bleu, comme si l’un s’apprêtait déjà à prendre le relais de l’autre, tandis que la figure unique d’été et d’hiver s’impose, massive et peinte en rouge, sous la forme d’un gros personnage dont les jambes pendent jusqu’aux genoux de la cariatide en été, et sont repliées en hiver.
Un double mouvement anime les sculptures. Celui des corps se déroulant autour de leur axe central, redoublé par celui du groupe sculpté, disposé de manière à former une ronde, évoquant le mouvement de la terre autour du soleil d’où dérive la division de l’année en quatre saisons. Une entorse curieuse faite à l’anatomie des créatures de marbre renvoie également au phénomène astronomique : leur fesse systématiquement tronquée évoque les solstices marquant les passages d’une saison à une autre, l’avènement ou le déclin d’un cycle.
À travers ce thème des quatre saisons, Pistoletto développe une réflexion sur l’évolution des formes dans le temps, leur altération inévitable. A chaque saison ses métamorphoses, ses naissances et ses morts. Combinant au sein d’une même oeuvre une figure renvoyant à l’Antiquité grecque et une autre rappelant les sculptures sur bois des expressionnistes allemands, on embrasse également, comme en raccourci, l’histoire des formes dans l’art, ses révolutions.
Michelangelo Pistoletto
Galerie de France, Paris
Pour paris-art.com, 2004