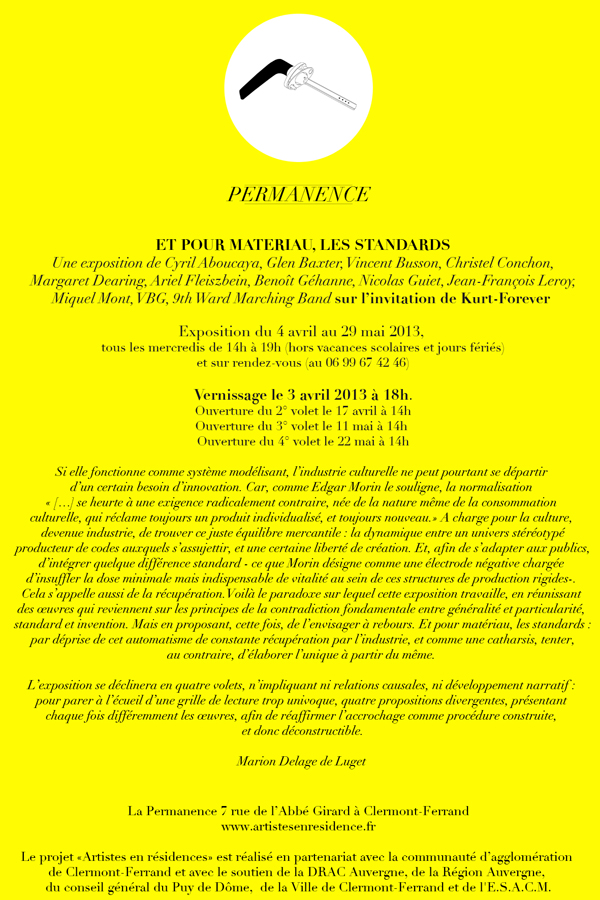Indéfinir les lieux
Tout, dans le travail de Margaret Dearing, est question de lieu. Ceux-ci qu’elle photographie d’abord, sites naturels ou urbains qui ont cette curieuse propriété de paraître parfaitement familiers alors même qu’il est absolument impossible d’en déterminer précisément la localisation. Déjà-vu cet immeuble terne, décati, avec ses balcons tristes sur lesquels fleurissent çà et là un étendoir, une parabole, ou ce morceau d’asphalte qui se détache en gravillons, et la chaussée qui craque. Rien que d’ordinaire et banal – un mur de moellons grossiers, décrépis, la course des nuages, ou encore cet arrêt marqué au bout du ponton, face aux eaux calmes. Des images génériques, jouant du lieu commun pour ne jamais céder à l’exemplarité du superlatif, surtout lorsque les vues pourraient être spectaculaires : l’impressionnante plongée sur cette immense chaîne de montagnes a finalement quelque chose d’une image d’Épinal, parce que les sommets s’étagent au lointain en une curieuse répétition, formant un tapis pour ainsi dire régulier, si près d’être uniforme que le panorama pourtant majestueux y perd de son emphase. Peu importe d’où la photographie provient, il n’y pas dans cette œuvre de hauts lieux – puisque même les paysages les plus grandioses n’échappent pas à l’anonymat d’une certaine stéréotypie. Cela tient au fait que Margaret Dearing élude toujours soigneusement dans ses images tout ce qui pourrait renseigner exactement une situation géographique. Elle donne ainsi à voir des espaces qui, parce qu’ils résistent au positionnement, deviennent quasi interchangeables – de ces lieux, quotidiens mais jamais clichés, relevant plutôt de cette approximation par omission, à même de dépasser les particularités pour mieux résumer un genre. Margaret Dearing cadre méticuleusement pour obtenir l’indéfini, rendant des espaces dont il s’avère du coup particulièrement difficile d’appréhender les limites – la section de trottoir, le rectangle de ciel ou la volée de marches, autant de fragments qui indexent un continuum dont ils ont été prélevés, donc une plus vaste totalité. Alors, au-delà de la portion de territoire effectivement photographiée, ce qui est saisi c’est, hors champ, tout un environnement, la coupe du cadre ne venant pas tant circonscrire un espace qu’en laisser supposer l’incommensurable étendue.
De bout en bout, le travail de Margaret Dearing est question de lieu ; jusqu’à celui-là dans lequel elle expose. Car nous y voilà, Ici, entourés de ces grandes horizontales que l’accrochage dessine, enfilades encore soulignées par les rectangles allongés des formats. Les photographies se succèdent à intervalles irréguliers, l’alignement suggérant de l’une à l’autre un prolongement. Surtout que nombre de « motifs » proches, sinon substituables, se répètent de part en part, procurant l’étrange sensation que l’on regagne ponctuellement le même endroit : que les immeubles se jouxtent réellement ou pas, ils composent ce vaste quartier périurbain auquel on revient sporadiquement, et ce pourrait être un seul et même bosquet d’arbres aux environs, donnant d’un côté sur le fleuve, de l’autre sur la montagne ou les habitations. Le rapprochement au mur incite à trouver ces proximités, comme cet immense ciel de nuages qui se retrouve pris au piège dans le miroir de la flaque d’eau au sol, accrochée à peine plus loin. Ou ces deux troncs aux pieds desquels s’étale une herbe rase, que l’on assimile d’un coup d’œil à la futaie dont l’image suivante, dans le sens de lecture, nous montre les frondaisons. Ce travail est ainsi traversé par toute une série de chaînes métonymiques qui, passant outre d’évidentes dissimilitudes, instaurent entre les photographies un rapport entêtant de contiguïté.
Le lieu d’exposition permet à Margaret Dearing d’en composer un autre, espace tout théorique d’où elle livre cette vue d’ensemble sur son travail. Ici, c’est le lieu du discours plasticien, l’endroit à partir duquel l’œuvre peut s’articuler, s’énoncer. Il faut véritablement considérer le parti pris de cette mise en espace. La suite de photographies se déroule, rappelant l’enchaînement de pictogrammes – comme si les vides entre elles rejouaient les portions de pellicule non impressionnées, espaces aveugles nécessaires au bon défilement de la séquence. La référence aux images animées n’est pas fortuite, car ces silences que Margaret Dearing installe génèrent bel et bien un flux : tels des cuts distinguant différents plans, ils ouvrent à l’éventualité du montage. Séparer pour susciter la re-liaison. C’est ce que préconise Pelechian : disjoindre les plans, afin que les intermédiaires qui les tiennent à distance viennent amplifier une signification qu’un voisinage direct, plus évident donc plus univoque, aurait de fait amoindrie. C’est dans cette idée que Margaret Dearing ménage dans l’accrochage ces pauses, ces respirations : pour dire le potentiel de relations entre des lieux pourtant éloignés, disparates. Aussi pour laisser au regardeur cette marge dans laquelle flâner, comme dirait Benjamin. Les interstices – autant d’entrées, de bifurcations, de passages possibles –, permettent de déambuler parmi l’ensemble de photographies. Moments sans images, ils sont le lieu possible du trait d’union ; là où, grâce à cette spatialisation singulière, chaque photographie, non plus juste circonscrite à ses propres limites, prend véritablement sens en regard des circonstances.
Dans le travail de Margaret Dearing, il est également question de temps – celui dont il est maintenant admis qu’il agit comme une dimension de l’espace. Car tout comme elle s’attache à indéfinir les lieux pour qu’ils signifient avec une plus grande justesse l’immensité qui nous entoure, elle transcrit en photographie cette durée démesurée, exactement inverse à l’idée de l’instantané. Au fil de l’accrochage déjà le bord de mer, la neige, évoquent une saisonnalité. Cela se perçoit d’autant lorsque ces arbres, ici nus, reverdissent plus loin, marquant la périodicité. D’autres éléments subissent ainsi successivement des transformations : l’eau par exemple, celle dont se compose ces nuages, qui s’écoule, liquide, puis que l’on retrouve vapeur, et plus loin cristallisée en flocons. Ces changements d’états, parfois pris sur le vif, photographiés en cours, laissent alors entrevoir ce qui semble être une inexorable dégradation. C’est dit au travers de ces couples de grands formats posant des équivalences entre menus détails et grands espaces. Les dépôts calcaires dégoulinant le long de l’escalier, concrétions résultant de l’action patiente du ruissellement de la pluie, sont à l’échelle des cimes enneigées ; les traces infinitésimales de résidus, usure anecdotique, à ras de terre, élevées au rang du ravinement de ces hauteurs majestueuses. Tout est voué à se valoir finalement, le plus insignifiant renvoyant à l’exceptionnel. Et inversement. Margaret Dearing trouve en chaque évènement, fût-il aussi minime et transitoire que cette empreinte de pneu qui vient creuser la boue, un indice permettant de manifester l’incommensurable – ce mouvement géologique qui se poursuit à l’échelle des continents. C’est encore la moto qui rouille, couchée dans l’herbe. Le gigantesque tas de sable au premier plan, engloutissant la base des immeubles, comme résultant de leur lent délitement. Mais ce n’est pourtant pas simplement la commutation extrême, irréversible de l’entropie. Car on pourrait tout aussi bien lire à rebours : l’amas de sable dont jaillissent les bâtiments du même béton. Si Margaret Dearing photographie ce qui s’altère, se désagrège, c’est dans l’idée non pas de noter l’imminence de l’arrêt, de poser le constat d’une stase inévitable, mais bien celui d’un cycle. Tout passe, comme les eaux de ce fleuve, et les remous boueux charrient de précieuses alluvions. Ce long processus de pulvérisation, de dissolution qui attend toute chose, peut aussi bien exprimer le commencement et la croissance : sur la pellicule d’eau stagnante photographiée plein cadre fleurissent les lichens d’un nouveau microcosme. Le temps est circulaire, et Margaret Dearing rejoue spatialement cette idée de boucle afin que ce moment d’arrêt, instant à jamais suspendu qu’est la photographie, se voit dans l’accrochage réactivé dans le flux des possibles, des devenirs ainsi occasionnés.
Marion Delage de Luget
Ecrit pour l'exposition Margaret Dearing - Ici, Progress Gallery 2015
Suite