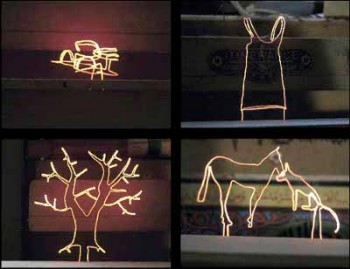La nouvelle littéraire est le format à partir duquel Sarah Dobaï a réalisé l’ensemble des portraits exposés. Les titres, Lorraine as Cora, Patrick as Billy, accolant le nom du modèle au personnage qu’il représente, renseignent déjà sur la nature de ces portraits, à cheval entre fiction et réalité.
Ces deux photographies composent la série de Two on a Party, histoire de Tennessee Williams, d’un jeune garçon et une femme d’âge mûr que la précarité, la fuite en avant perpétuelle, poussent à s’associer en un couple bancal. La nouvelle de Williams qui procède d’un constant mouvement de va et vient entre Cora et Billy et s’inscrit toute entière dans la réalité produite par ce couple est évoquée par la photographe en une confrontation de leurs portraits, engageant les figures en un jeu d’opposition de sexes, d’âge et de physionomie.
Mais les deux portraits se répondent essentiellement par une même vulnérabilité physique. La rougeur des peaux trahit le malaise du jeune garçon assez gauche, dont la peau de blond s’empourpre si facilement, et l’alcoolisme de la femme dont les yeux gonflés sont décrits par Williams comme « deux œufs pochés dans une mer de sang ». Les postures, les regards, les mains ajoutent encore à l’éloquence de ces portraits. Des doigts nerveusement croisés du garçon au geste de la femme se tortillant une mèche de cheveux.
Bien que l’éloquence des photographies y soit pour beaucoup, on est aussi retenu par la forte présence des personnages. Un travail attentif de la lumière incarne dans le détail leur carnation, l’étoffe des vêtements. On songe également, par l’attention portée par la photographe à la composition et aux postures corporelles des modèles, à toute une tradition picturale du portrait, de Vélasquez à Géricault.
Les photographies réalisées d’après les nouvelles de Carver condensent également à travers leurs nombreux détails de mise en scène et d’ordre sensible un ensemble de données narratives qui en renforcent le côté cinématographique. Ces fragments de récit semblent toujours pris entre un avant et un après qui conduit à en prolonger la vision par des projections imaginaires.
A la manière de ces écrivains capables de décrire avec une précision de scénariste des attitudes et des comportements, Dobaï livre en ces images synthétiques et denses des pans d’histoire, quelques thèmes typiques de la littérature et du cinéma américain.
Le peintre anglais Dan Hays peint depuis son atelier des paysages du Colorado, vus à travers une webcam. Ces images sont le fruit d’une recherche ludique de l’artiste effectuée sur internet à partir de son nom et prénom. Il découvre ainsi les images de son homonyme, un sénateur américain ayant placé des webcam en divers endroits de sa propriété afin de pouvoir la contempler de son bureau. Anecdote, peut-on dire, mais qui rappelle l’intérêt porté par l’artiste aux images triviales de pauvre définition à partir desquels les désirs sont néanmoins mis en scène, ici peut-être, ceux de maîtrise ou de possession.
Mais cette matière première est aussi choisie pour sa surface, dont le peintre rehausse, par petites touches de couleurs vives la division des pixels, la trame particulière de l’image sur écran en une sorte de fauvisme numérique hypnotique. Disposées côte à côte, les différents tableaux composent une grille où sont présentées plusieurs vues simultanées du même paysage. Des tentes et des camping-car apparaissent régulièrement sur cette étendue naturelle que ferment des montagnes. Le titre, Colorado Pioneers, renvoie d’abord aux mythes américains de la conquête de l’Ouest, de la frontière entre nature et culture. Cette idée de conquête de nouveaux espaces est redoublée par le recours même du peintre aux nouvelles technologies qui prennent le relais de la perception naturelle et lui permettent de peindre non pas sur le motif, mais de son atelier à Londres. Les vues plongeantes, panoramiques, multipliant les points de vues sur un même endroit excèdent la perception naturelle, relevant plutôt d’un dispositif semblable à celui de la vidéo surveillance. La peinture de paysage trouve ici de nouveaux territoires.
Sarah Dobaï & Dan Hays
Galerie Zürcher, Paris
Pour paris-art.com, 2004
Suite