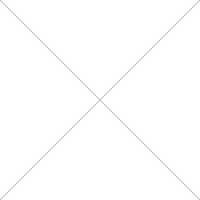« La photographie contemporaine à l’épreuve du temps » in François Soulages (dir.) Photographie & Contemporain. A partir de Marc Tamiser, Paris, L’Harmattan, pp 33-41
Quel est le temps propre à la photographie contemporaine ? Émergeant du présent, elle a pourtant vocation à perdurer dans le temps. Quelle est alors la particularité de cette photographie plasticienne au regard d’une image consommée ? L’ouvrage de Marc Tamisier intitulé Sur la photographie contemporaine[1] tente de définir ce que serait une photographie de son temps. Selon l‘auteur, elle a pour particularité de se situer dans un temps présent, à l’inverse de la photographie qu’il nomme anté-contemporaine. La contemporanéité de la photographie la place donc dans un temps présent indépendant de l’espace historique, c’est-à-dire qu’elle dépasse l’ancrage spatio-temporel de l’instant de la prise de vue, dans ce refus d’adhérence au réel qui la caractérise. Il sera question dans ce texte de confronter la photographie contemporaine à l’épreuve du temps. Si cette dernière émerge du présent, nous tenterons d’appréhender la distinction opérée par Marc Tamisier entre les « traces laissées par le temps»[2] et les « traces du temps lui-même»[3] comme différence essentielle entre approche évoluant dans l’espace-temps de l’événement médiatique et approche soumise à la temporalité de l’œuvre. Cette analyse ouvrira à des interrogations sur le temps de la photographie contemporaine et notamment celui de sa réception au public. En effet, quel est aujourd’hui l’intérêt de faire front à Fait[4], œuvre de Sophie Ristelhueber inspirée de la deuxième guerre du Golfe ? Si la dimension mnémonique d’un tel travail ne nous semble pas essentielle, en quoi cette œuvre peut-elle encore aujourd’hui se situer dans une problématique contemporaine du temps présent, alors que les traces du conflit sur le territoire ont peut-être disparu ? Le mur d’images que constitue Fait joue sur l’échelle en juxtaposant vues aériennes enregistrées depuis un avion et images de détails de ces sols cicatrisés, glanés sur le terrain. La photographe se focalise sur ces traces présentes à même la terre : témoignages du conflit ou bien preuves d’un passage, Sophie Ristelhueber porte son attention sur ces marques laissées par l’homme dans un territoire. Elle intervient alors que le conflit n’est plus d’actualité, s’attachant à enregistrer ces éléments avant que la poussière ne les recouvre à son tour. Cette installation, constituée d’images composant une mosaïque murale, se présente comme une surface sensible, quasi-corporelle, à l’image de ces cicatrices qui marquent d’un sceau le souvenir de la douleur. Le travail de Sophie Ristelhueber, aux frontières du reportage, conduit à s’interroger sur le rapport au temps. Si son propos aborde des problématiques communes à la presse, elle se place volontairement en retrait de ce système, que ce soit de façon spatiale comme temporelle. Son travail, prenant la forme d’installation le plus souvent, est guidé par la cicatrice, leitmotiv de toutes ses séries. Dans l’analyse que Marc Tamisier en propose, il distingue à juste titre deux manières d’appréhender les traces du temps dans ses œuvres : la présence au sein de l’image de « traces laissées par le temps » et d’autre part, les « traces du temps lui-même ». Les premières introduisent le sujet, c’est-à-dire qu’elles témoignent de l’événement passé dont les marques tendent à s’effacer. Il s’agit de preuves du « présent contre le temps », comme le pratique généralement la photographie de presse. Il y a une urgence de l’instant, pour celui qui immortalise le moment, mais aussi pour celui qui consommera l’image. Telle est la logique des mass-media et du système fluctuant de l’image-événement. Cette attitude tente de contrer l’inéluctable disparition des traces du temps au sein du territoire. L’économie visuelle inhérente au mass-media est victime de l’accélération rythmant la temporalité du contemporain. Si, pour Marc Tamisier, l’arrivée du numérique dans le champ photographique a conduit à remettre en cause l’appréhension du medium, il n’en demeure pas moins que cette révolution amène surtout à repenser les modes de perception et de représentation de l’espace-temps du contemporain. L’accélération a été une donnée fondamentale dans la photographie de presse notamment au XXème siècle et a conduit à appréhender l’image consommée comme une image-flux, dans la logique de cette esthétique de la disparition prônée par Paul Virilio[5], où chaque image s’efface afin de laisser place à la suivante. Dans le monde de la presse, la course à la vitesse est justifiée par la nécessité de se situer de plus en plus prêt temporellement de l’événement. Pour Vincent Lavoie[6], cette compression temporelle guide les modes de fonctionnement de l’industrie des mass-media. L’auteur s’attache à souligner la tendance de la presse à ancrer l’image-événement dans l’instant de l’histoire. Mais, si certaines de ces images tentent de s’affranchir de l’actualité dont elles sont pourtant issues, elles ne semblent pas pour autant détachées de leur contexte spatio-temporel et de leur volonté de faire histoire. C’est à cela que Sophie Ristelhueber veut s’opposer en photographiant les “marges de l’événement“[7]. Le rapport frontal établi entre œuvre et public est le propre de ces artistes qui abordent la question de l’altérité tout en s’inscrivant au sein d’une pratique inspirée notamment de l’actualité. Il s’agit de ceux dont le travail concerne le social, proposant une représentation à la fois distante et critique de ces situations. Aussi, la nostalgie que procure au spectateur la référence à l’espace-temps d’un événement médiatisé peut conduire à détourner le propos de l’artiste. Car le sens de la photographie contemporaine appartient surtout à la lecture qu’en fera le public pour Marc Tamisier. En effet, ces images inspirées de l’actualité n’abordent pas tant l’événement dont elles sont issues, mais au contraire jouent sur ces références pour porter un autre discours sur ces faits et rendre à l’image sa dimension symbolique. Si pour Vincent Lavoie le domaine de l’art tente « une réhabilitation du genre historique dans la perspective d’une relecture critique de celui-ci»[8], on serait tenté de penser que certains artistes dépassent cette relation à l’histoire en donnant une dimension plus universelle à leur approche. Aussi, lorsque Sophie Ristelhueber élabore le travaille qu’elle nommera Fait, elle fait certes référence à un événement diffusé par les mass-media et ancré dans l’instant présent, mais elle s’inspire surtout d’une image publiée dans un magazine dont la plastique la conduit à focaliser son attention sur le motif de la cicatrice. Car ce travail est bien plus associé à l’ensemble de la démarche de l’artiste qu’à l’imagerie relative à l’événement de la guerre du Golfe. L’approche de Sophie Ristelhueber peut donc difficilement être considérée comme un témoignage de plus sur le conflit, tant la représentation symbolique de la marque de la douleur est omniprésente dans son œuvre. Cette analyse du présent proposée par Sophie Ristelhueber n’est pas sans rappeler la définition du contemporain élaborée par Giorgio Agamben : « elle est très précisément la relation au temps qui adhère à lui par le déphasage et l’anachronisme »[9]. À cette attitude propre au contemporain, le philosophe y oppose celle d’individus coïncidant trop à leur époque et donc ne pouvant prendre la distance nécessaire à sa compréhension. Il semblerait donc que cette contemporanéité soit le propre de la photographie contemporaine, là où la relation directe établie par l’image de presse empêche de porter un jugement et de se détacher du présent. Le propre de la photographie contemporaine serait alors de prendre l’objet pour ce qu’il n’est pas, comme l’énonce à juste titre Catherine Rebois : « La photographie contemporaine paradoxalement ne nous montre pas une reproduction réaliste de l‘objet, malgré le recours à cette procédure technique rigoureuse, puisqu’elle le coupe de toute réalité et le met hors contexte.»[10] Pour ce qui est de son travail, Sophie Ristelhueber utilise la guerre du Golfe comme prétexte afin d’aborder un sujet plus large et plus universel que celui d’un conflit, qui est de fait ancré dans une histoire et une géographie. Cette spécificité de la photographie contemporaine la distingue d’autant plus d’une photographie consommée et appliquée dont la lecture serait normée. Le spectateur doit alors se positionner en retrait de la perception première de l’image et de sa relation indéniable avec une réalité, quelle qu’en soit la nature. Les photographies de Sophie Ristelhueber révèlent l’opacité de l’image. Ses all-over se situent volontairement en retrait de la représentation transparente de l’événement. L’œuvre Fait, par sa plastique ne se résume pas au sujet traité, alors que l’artiste semble aborder bien plus la symbolique de la cicatrice que celle de l’histoire d’une guerre. Comme l’énonce Marc Tamisier, à travers cette œuvre, il s’agirait surtout de la matérialisation d’un concept, celui du « temps comme trace ». La symbolique de la cicatrice révèle cette présence continue, quasi-éternelle de la blessure du temps, qui finit par se transformer en trace, dans la représentation de ces lieux où semblent s’enraciner un présent éternel. Les cicatrices du temps sont alors présentes dans l’image elle-même, dont l’ancrage spatio-temporel témoigne de la douleur du propos. Le public se réfère en premier lieu à sa connaissance du conflit par le biais des images relatives à l’événement, diffusées par les mass-media. Si ces dernières imposent une interprétation par le texte qui les accompagne, les œuvres de Sophie Ristelhueber invitent au contraire à en faire une autre lecture. C’est ainsi que le spectateur fait front à l’image afin d’y voir ce qu’il recherche. La compréhension de ces images ne peut donc se résumer à leur relation au conflit, simple pré-texte à création. Ces photographies, par leur référence à la cicatrice, témoignent de la persistance de la douleur et semblent tout de même avoir pour vocation de garder en mémoire, non pas la douleur spécifique à un événement, mais bien le rapport que chacun de nous entretient avec cette dernière. Mais comment cette « trace du temps » agit-elle sur le spectateur ? N’impose-t-elle pas une durée qui diffère de l’instant présent propre à l’image mass-médiatique ? On pourrait supposer que cette appréhension du temps se présente comme une construction de cette confrontation entre spectateur et photographie. Elle serait constituée de deux moments : le premier appartiendrait à la perception et ferait référence à la surface sensible de l’image, là où le deuxième inviterait à puiser dans la mémoire de chacun. Cette persistance de la trace temporelle pourrait être appréhendée comme un présent qui dure, un temps qui serait à comprendre comme marque, comme un repère que le spectateur pourrait y trouver pour se référer à sa propre mémoire de l’événement. On serait tenté de comprendre ce travail sur l’autre, développé par Sophie Ristelhueber, comme une approche un tant soit peu universelle de l’histoire du temps présent. Ces cicatrices qui perdurent au temps passé, présent et futur contribueraient à la mise en œuvre de la représentation d’une « guerre générique[11] » évoquée par ces photographies-cicatrices. Par-delà ce motif, il s’agit d’appréhender les marques du conflit visible, relatif à l’actualité, mais aussi celles de conflits personnels, inhérents à tout individu. C’est pourquoi ces images diffèrent de celles des mass-media, non plus par ce qu’elles représentent, mais par leur immersion dans un milieu, celui de l’art contemporain, où le spectateur créé ce rapport de frontalité à la photographie. Frontalité qu’il faudrait penser au regard du point de vue de Jacques Rancière : « il faut un théâtre sans spectateurs, où les assistants apprennent au lieu d’être séduits par des images, où ils deviennent des participants actifs au lieu d’être des voyeurs passifs [12]». Le spectateur ne doit pas se cantonner à la posture de celui qui voit et subit l’œuvre à laquelle il fait face, sans pour autant se considérer comme partie prenante de la production artistique. Car le rôle du spectateur est aussi d’agir en fonction de ce qu’il observe et qu’il interprète l’œuvre au regard d’une connaissance et d’un vécu personnel. S’opère alors le décalage avec ce que l’artiste a voulu dire au sein de son œuvre et l’interprétation qu’en fait le spectateur sensibilisé à une autre histoire, acteur de son histoire. Ainsi, l’émancipation telle que l’appréhende Rancière serait « le brouillage de la frontière entre ceux qui agissent et ceux qui regardent, entre individus et membres d’un corps collectif»[13], donc entre le photographe et le spectateur faisant front à l’image. Car la mise en scène que crée le musée et la salle d’exposition invite aussi le spectateur à créer une autre relation avec l’image, que l’on souhaiterait aux antipodes de celle qu’impose les mass-media, c’est-à-dire plus consommée que ressentie et dont la temporalité s’inscrit indéniablement dans l’instant présent. Sophie Ristelhueber a pour habitude de puiser son inspiration dans le champ de l’information sans pour autant adhérer ni à l’espace, ni au temps des événements relatés. Dans la même lignée, une part non négligeable d’artistes contemporains a fait de l’actualité sa source d’inspiration. L’attitude qu’ils privilégient le plus souvent est de se situer en retrait de l’événement, que cette distance soit temporelle ou bien spatiale. Cette distance induit le détachement à l’image mass-médiatique référente et invite aussi à en faire une appréhension ouvrant à de multiples lectures possibles. Ce qui importe dans le processus de compréhension et d’appropriation de l’œuvre par le public est cette distance temporelle. Car, même si l’artiste agit dans un temps similaire à celui du déroulement de l’événement, en parallèle à la presse, la présentation de l’œuvre ne se situera pas pour autant dans un même temps et une même durée que celle des mass-media. Prenons l’exemple du travail de Brunon Serralongue[14]. Jouant avec l’univers de la presse, il interroge dans certains de ses travaux cette relation temporelle imposée par les media de masse, le conduisant à la production d’une image jouant avec la simultanéité de sa diffusion, là où son intégration dans le milieu de l’art impose de fait un décalage temporel. Mais il expérimente d’une certaine manière le décalage spatial dans la mesure où, ne possédant pas de carte de presse, il est obligé de se positionner en marge des tribunes réservées aux professionnels de la médiatisation d’un événement. L’utilisation d’une chambre photographique ne fait que justifier cette recherche d’une alternative à la course à la vitesse instaurée dans le monde de la presse. Et lorsqu’il a joué avec la frontière séparant l’art de la presse en travaillant comme pigiste dans une rédaction, il a, par la suite, exposé ses images publiées dans les journaux au sein des institutions culturelles, mais amputées de leur légende. Bruno Serralongue conduit alors à s’interroger sur l’économie de l’image aujourd’hui, distinguant non pas la photographie argentique de la photographie numérique, mais bien plus deux économies parallèles de l’image, distincte quant à leur temporalité et quant à leur réception. Comme l’énonce Franck Leblanc[15], cette « image-flux » ne serait peut-être pas que le fait d’une technique, mais surtout d’un type d’utilisation, de support et de diffusion. Pour l’auteur, cette image est caractérisée par la mobilité qui l’anime, entre phase de production, de traitement, de diffusion, de suppression. Ainsi, l‘image de presse et l’image télévisuelle inhérentes à une actualité sont appréhendées comme images fluctuantes ; leur statut restant à repenser lorsqu’elles sont extraites d’un tel contexte. Tel est le cas pour l’image de presse muséifiée, pratique courante chez un photographe comme Luc Delahaye. Quelle est alors la valeur et le statut de ces images ? Cette adhérence au sujet, cette apparence un tant soit peu illustrative n’empêche-t-elle pas la dimension symbolique de l’art d’opérer ? Pour Vincent Lavoie, « l’image de presse est autorisée à intégrer le musée dans la mesure où elle prend en charge la représentation des grands événements de l’histoire ». Tel est du moins la tendance qui s’est développée, selon l’auteur, au sein des institutions culturelles dès la première moitié du XXème siècle. Ce phénomène n’a fait que s’accroître d’années en années pour devenir quasiment un genre de la photographie contemporaine aujourd’hui. Si le double usage de l’image n’est pas condamnable pour autant, la “plasticification“ de la photographie pour la rendre propre au monde artistique l’est. Il ne s’agit pas de mettre en doute les capacités d’un journaliste de faire œuvre, mais plutôt d’interroger le double usage d’une image à laquelle on plaquerait un mode de présentation propre à ce qu’on peut nommer photographie plasticienne. Cette photographie aurait donc comme particularité d’être dotée d’une double temporalité, celle de l’instant présent de l’image médiatique et celle propre à la photographie contemporaine. Mais en quoi ces photographies interrogent-elles ce passage d’une image ancrée dans un présent à une image dont la contemporanéité l’a fait perdurer au-delà de son époque ? D’un autre côté, l’œuvre d’art s’inspirant d’une actualité invite à se référer à l’espace-temps de l’événement pour ensuite laisser opérer le décalage recherché par l’artiste, tout en permettant au public d’appréhender le travail en ayant une connaissance du sujet. Connaissance qui fera surface lors de cette confrontation, dans la perception première de l’œuvre, mais aussi dans la relation qui va se créer entre cette œuvre et le spectateur, libre de l’interpréter comme il le souhaite. Il semblerait que cette appropriation dépasse alors le sujet-même de la photographie. Ces photographies relèvent d’une forme d’universalité qui dépasse la référence au sujet. Si elles se réfèrent au temps présent, c’est parce qu’elles font émerger des problématiques qui se situent au premier abord dans une histoire collective, dont les prémices ont été construites par la presse, mais aussi à une histoire individuelle. C’est ainsi que Ristelhueber place au cœur de son propos la marque d’un temps qui perdure par-delà le présent et s’inscrit dans un espace qui n’est plus celui de la médiatisation de l’événement. L’œuvre Fait, qui a donc pour origine la seconde guerre du Golfe, est exposée en 2009 à la Galerie du Jeu de Paume à Paris. L’intérêt d’un tel travail n’est pas d’informer sur l’événement photographié, mais plutôt d’enrichir le sujet que l’artiste développe dans ses nombreux travaux, c’est-à-dire celui de la douleur comme marque. La guerre ou bien la référence à l’enfance ne serait donc que prétexte à création, car la dimension universelle d’un tel problème ne peut se résumer à une représentation alternative d’un fait historique, majeur comme mineur. Malgré l’intérêt de l’artiste pour la question du territoire et pour une attitude en marge du monde de la presse, tant au moment de la prise de vue, qu’à celui de la diffusion de l’œuvre, elle semble avant tout privilégier cette persistance de l’œuvre au fil du temps, comme la volonté de faire perdurer cette marque d’un temps au sein de la temporalité de la photographie contemporaine. Si, pour Marc Tamisier, la photographie contemporaine s’inscrit dans le temps présent, on peut également considérer, qu’au regard de la photographie consommée, sa particularité réside aussi dans la persistance de l’œuvre dans le temps. À la différence de la photographie d’histoire, cette adhérence au temps ne correspondrait pas à un quelconque devoir mnémonique, mais participerait du concept de l’artiste tentant de donner un caractère universel à un problème qui a pourtant émergé de l’instant de l’image événement. Mais, cette conception de la photographie contemporaine est pensée au sein de son présent, alors que rien n’informe de son devenir et de sa capacité à survivre dans le temps. Si la photographie contemporaine invite à penser le présent, en aura-t-elle les capacités lorsqu’elle aura peut-être perdu cette référence au contexte spatio-temporel ? Quel est le pouvoir symbolique de ces œuvres tirées du présent dont elle s’inspire et au sein duquel elles sont destinées pour le moment à évoluer ? Si elles ont comme particularité de ne pas s’attacher à un quelconque devoir mnémonique, quelle serait alors leur place au sein d’une autre époque dont les acteurs tenteraient d’en produire une analyse afin de comprendre le présent de ces œuvres ?
[1] Marc Tamisier, Sur la photographie contemporaine, Paris, l’Harmattan, 2007. [2] Idem, p.148. [3] Idem, p.148. [4] Sophie Ristelhueber, Fait, Paris, Hazan, 1992. [5] Paul Virilio, Esthétique de la disparition, Paris, Galilée, 1989. [6] Vincent Lavoie, « Photographie et imaginaires du temps présent », in Maintenant, Images du temps présent, Montréal, Mois de la photo à Montréal, 2003, p.18. [7] Vincent Lavoie, « Photographie et imaginaires du temps présent », op. cit, p.22. [8] Idem, p.24. [9] Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ?, op. cit., p.11. [10] Catherine Rebois, De l’objet dans la photographie contemporaine. [11] Expression empruntée à Ann Hindry, Sophie Ristelhueber, Paris, Hazan, 1998, p.28, reprise par Marc Tamisier, op. cit., p.147. [12] Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2008, p.10. [13] Idem, p.26. [14] Ce photographe contemporain travaille sur le même terrain que la presse, mais ne possède pas de carte de journaliste, photographie à la chambre et présente ses images dans le champ de l’art contemporain. www.brunoserralongue.com [15] Franck Leblanc, La photographie numérique comme question de temps.
Suite